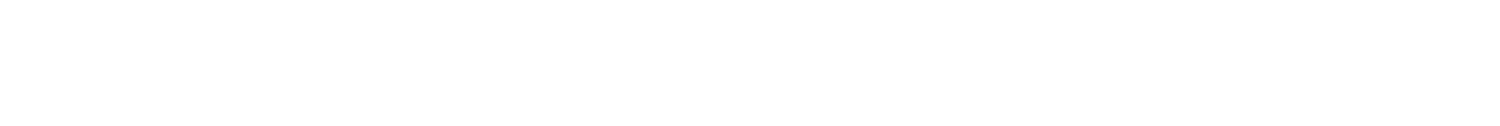@Mayushi ok je comprends, merci !
Oui c'est toute la question, à partir du moment où les autorités ont eu les données entre les mains, ont-elles pris des actions pour faire cesser le désastre ou pas ?
Et puis il y a quand même un principe de précaution qui peut s'appliquer, est-ce que c'est pas un peu facile de se cacher derrière le "on savait pas" ?
Je n'y connais pas grand chose en droit et j'imagine qu'il doit y avoir des subtilités à l'oeuvre, mais clairement ce genre de décision ne va pas améliorer la défiance entre les DOM et la métropole.