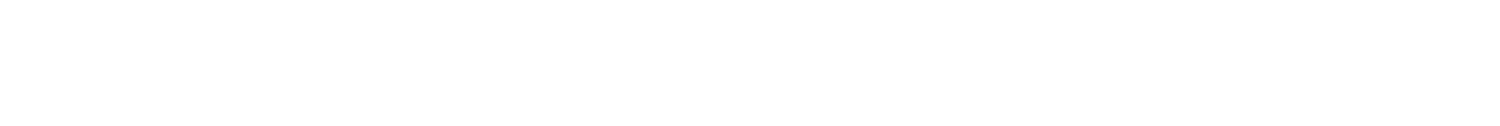Le dernier film que vous avez vu à la maison
- Initiateur de la discussion Yana
- Date de début
Vous utilisez un navigateur obsolète. Il se peut que ce site ou d'autres sites Web ne s'affichent pas correctement.
Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Je viens de regarder Ed Wood qui passait sur Arte et j'ai vraiment aimé, c'est intéressant et très bien fait. Je suis tombée dessus par hasard donc j'ai raté le début et je regrette, et j'aurais du lire une rapide biographie d'Ed Wood avant pour mieux comprendre toutes les références! Johnny Depp est merveilleux comme toujours!
Plusieurs films de Tim Burton passent sur Arte jusqu'au début janvier et je ne vais surtout pas rater ceux que je n'ai jamais vu!
Sinon j'ai aussi vu Premium Rush avec Joseph Gordon Levitt que j'adore donc rien que pour lui j'ai aimé, c'est plutôt sympa comme film mais ce n'est pas le genre de trucs que je regarderai plusieurs fois. Mais j'ai passé un bon moment!
Et en matière de dessin animé j'ai vu Volt, star malgré lui et c'était génial! J'ai troop rigolé et il y a aussi des passages super émouvants, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas regardé plus tôt!
Bref, c'est les vacances et j'en profite pour regarder des films que je n'avais jamais vu!
Plusieurs films de Tim Burton passent sur Arte jusqu'au début janvier et je ne vais surtout pas rater ceux que je n'ai jamais vu!
Sinon j'ai aussi vu Premium Rush avec Joseph Gordon Levitt que j'adore donc rien que pour lui j'ai aimé, c'est plutôt sympa comme film mais ce n'est pas le genre de trucs que je regarderai plusieurs fois. Mais j'ai passé un bon moment!
Et en matière de dessin animé j'ai vu Volt, star malgré lui et c'était génial! J'ai troop rigolé et il y a aussi des passages super émouvants, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas regardé plus tôt!
Bref, c'est les vacances et j'en profite pour regarder des films que je n'avais jamais vu!
La Vie est Belle, de Roberto Benigni. (à voir en VO Italien sous-titrés Français)
J'ai adoré. C'est un film magnifique. Ne lisez pas le synopsis, suivez juste le film, jusqu'au bout, vous serez surprise comme moi, et émue à la toute fin.
J'ai adoré. C'est un film magnifique. Ne lisez pas le synopsis, suivez juste le film, jusqu'au bout, vous serez surprise comme moi, et émue à la toute fin.
Comme Cendrillon, hier soir.
Je m'ennuyais, une amie m'a filé le lien, j'ai regardé. Film sans prise de tête, un teen-movie tout ce qu'il y a de plus classique.
Je m'ennuyais, une amie m'a filé le lien, j'ai regardé. Film sans prise de tête, un teen-movie tout ce qu'il y a de plus classique.
Autant en emporte le vent, de Fleming : Presque quatre heures de film, ça aurait presque pu paraître long ; mais c'est bien ce qu'il fallait pour adapter un tel roman. Forcément, des choix ont dû être faits, et la toile de fond qu'est la guerre civile et ses conséquences (quand elles n'interviennent pas directement sur la vie des protagonistes principaux) est largement reléguée au second plan. De même, la société sudiste d'Atlanta, ses moeurs, ne sont qu'effleurées dans deux ou trois scènes - et on perd un peu de vue alors ce qu'elle était et pourquoi Scarlett est tellement avant-gardiste et iconoclaste. Mais globalement, l'histoire, les personnages et leur caractère sont bien retranscris - et la "ressemblance" entre les personnages décrits et les acteurs est stupéfiante, personne d'autres n'aurait pu aussi bien correspondre aux personnages de M. Mitchell. Et l'image est magnifique. Donc, forcément moins de subtilités que le livre, mais une terriblement bonne adaptation tout de même.
(Ma plus grande déception par rapport à ce film vient quand même du personnage du père, dont, par le traitement et la place très courte qu'il occupe dans l'histoire, on ne comprend plus aussi bien le caractère, et surtout le changement qui s’opère entre le début du film et la suite ; alors que c'est quelque chose qui m'a terriblement marquée et bouleversée dans le livre).
Les Valseuses, de Bertrand Blier : J'ai trouvé la première partie du film insupportable par tout le jeu sur cette provocation délibérément machiste. J'avais donc eu peur de voir un film qui ne s'intéresserait qu'à la libération de la sexualité masculine, où la femme ne serait qu'accessoire ; mais lorsque la seconde partie débute, que la sublime Jeanne Moreau débarque, que la provocation trop gratuite s'estompe, le film devient plus intéressant, plus intelligent, moins long, et définitivement plus agréable. Mais sûrement par tout le recul que j'ai par rapport à ce film, je ne fais clairement pas partie des gens qui le portent aux nues.
(Ma plus grande déception par rapport à ce film vient quand même du personnage du père, dont, par le traitement et la place très courte qu'il occupe dans l'histoire, on ne comprend plus aussi bien le caractère, et surtout le changement qui s’opère entre le début du film et la suite ; alors que c'est quelque chose qui m'a terriblement marquée et bouleversée dans le livre).
Les Valseuses, de Bertrand Blier : J'ai trouvé la première partie du film insupportable par tout le jeu sur cette provocation délibérément machiste. J'avais donc eu peur de voir un film qui ne s'intéresserait qu'à la libération de la sexualité masculine, où la femme ne serait qu'accessoire ; mais lorsque la seconde partie débute, que la sublime Jeanne Moreau débarque, que la provocation trop gratuite s'estompe, le film devient plus intéressant, plus intelligent, moins long, et définitivement plus agréable. Mais sûrement par tout le recul que j'ai par rapport à ce film, je ne fais clairement pas partie des gens qui le portent aux nues.
H
_hazel_
Guest
Laisse tes mains sur mes hanches, de Chantal Lauby
(J’aurai pu aussi le citer dans vos films de fille/remonte moral .. )
(J’aurai pu aussi le citer dans vos films de fille/remonte moral .. )
Total Recall
Il est passé sur France 3 cette semaine, j'me suis laissée tenter, j'ai bien rigolé Nan c'est vrai, c'est quand même grave kitsh et carton-pâte, puis les doubleurs français rajoutaient du ridicule au truc, puis la gueule d'Arnold... Mais le sujet futuriste reste assez sympa, j'avais vu le remake, du coup, au regard de l'original, je le trouve très bien réussi.
Nan c'est vrai, c'est quand même grave kitsh et carton-pâte, puis les doubleurs français rajoutaient du ridicule au truc, puis la gueule d'Arnold... Mais le sujet futuriste reste assez sympa, j'avais vu le remake, du coup, au regard de l'original, je le trouve très bien réussi.
Il est passé sur France 3 cette semaine, j'me suis laissée tenter, j'ai bien rigolé
 Nan c'est vrai, c'est quand même grave kitsh et carton-pâte, puis les doubleurs français rajoutaient du ridicule au truc, puis la gueule d'Arnold... Mais le sujet futuriste reste assez sympa, j'avais vu le remake, du coup, au regard de l'original, je le trouve très bien réussi.
Nan c'est vrai, c'est quand même grave kitsh et carton-pâte, puis les doubleurs français rajoutaient du ridicule au truc, puis la gueule d'Arnold... Mais le sujet futuriste reste assez sympa, j'avais vu le remake, du coup, au regard de l'original, je le trouve très bien réussi.J'ai vu Bliss! aka Whip It! de Drew Barrimore, et si je jalouse/fantasme toujours autant sur Ellen Page, je dois admettre que c'est un beau film sur la jeunesse, avec ses amourettes foireuses, sa pseudo-rebellion, le tout sur fond de Ramones. Que demander de plus ? 

(500) jours ensemble
J'ai trouvé ça génial... Inattendu, drôle, décalé, vif et surtout révélateur.
Les acteurs sont géniaux : Joseph Gordon Levitt attachant et juste, Zooey Deschanel magnifique et la toute jeune Chloë Moretz est vraiment bien dans le rôle de la petite soeur perspicace 
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.

Frances: un film qui date des années 80, qui raconte l'histoire de Frances Farmer, actrice américaine qui a vu son talent réduit à néant dû à ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique.
Vraiment intéressant, bien que comme dans chaque film où il m'est donné de voir les traitements infligés aux patients de psy, je suis scandalisée. Comment pouvaient-ils, en tant que médecin, persister à juger les gens fous, à les enfermer avec des aliénés, à leur faire subir tous ces traitements inhumains et sans fondement scientifique, combien même parfois l'absence de folie crevait les yeux? C'est ignoble, inhumain, et j'ai toujours peur de savoir combien de vies ils ont sacrifié à s'entêter de la sorte? Celle de Frances, bien qu'elle ait réussie à revenir à la vie, n'était plus la sienne. Elle a perdu toute son authenticité.
Vraiment intéressant, bien que comme dans chaque film où il m'est donné de voir les traitements infligés aux patients de psy, je suis scandalisée. Comment pouvaient-ils, en tant que médecin, persister à juger les gens fous, à les enfermer avec des aliénés, à leur faire subir tous ces traitements inhumains et sans fondement scientifique, combien même parfois l'absence de folie crevait les yeux? C'est ignoble, inhumain, et j'ai toujours peur de savoir combien de vies ils ont sacrifié à s'entêter de la sorte? Celle de Frances, bien qu'elle ait réussie à revenir à la vie, n'était plus la sienne. Elle a perdu toute son authenticité.
Discussions similaires
- Réponses
- 0
- Affichages
- 365
- Réponses
- 0
- Affichages
- 467
- Réponses
- 0
- Affichages
- 581
- Réponses
- 0
- Affichages
- 542
Les Immanquables du forum
Participe au magazine !
Une info qu'on devrait traiter sur madmoiZelle ?
Nouvelle ou perdue ?
Pas de panique, on t'aime déjà !
La charte de respect du forum
Le guide technique &
le guide culturel du forum
Viens te présenter !
Un problème technique ?
Topic d'entraide sur l'orthographe et la grammaire
La chefferie vous informe
Les annonces de l'équipe concernant le forum et madmoiZelle
Rendre visite à madmoiZelle
Le médiateur du forum
Soutiens madmoiZelle financièrement
Topic dédié à la pub sur mad
Si vous aimez madmoiZelle, désactivez AdBlock !
Les immanquables
Les topics de blabla
En ce moment... !
Mode - Beauté - Ciné - Musique - Séries - Littérature - Jeux Vidéo - Etudes - Ecriture - Cuisine - People - Télévision
Envie de rencontrer des MadZ ?
Viens trouver le forum de ta ville !
Mode
Le pire de la mode
Ces vêtements qui te font envie
Ta tenue du jour
La tenue qui plaît
Tes derniers achats de fringues
Beauté
Astuces,bons plans économies & dupes
Le topic des vernis
Questions beauté en tout genre
Culture
Le meilleur des images du net
L'aide aux devoirs
Tu écoutes quoi ?
Quelle est ta série du moment ?
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Le dernier film que vous avez vu à la maison
Le topic philosophique
Société
Topic des gens qui cherchent du travail
Voyager seule : conseils et témoignages
Trucs nuls de la vie d'adulte : CAF, Banque, Mutuelle, Logement etc...
Les topics universels
Je ne supporte pas
Je ne comprends pas
Ca me perturbe
Je me demande
J'adore...
Je m'en veux de penser ça mais...
Cupidon
Le topic des amoureuses
Le topic des polyamoureuses
Les Célibattantes
Une info qu'on devrait traiter sur madmoiZelle ?
Nouvelle ou perdue ?
Pas de panique, on t'aime déjà !
La charte de respect du forum
Le guide technique &
le guide culturel du forum
Viens te présenter !
Un problème technique ?
Topic d'entraide sur l'orthographe et la grammaire
La chefferie vous informe
Les annonces de l'équipe concernant le forum et madmoiZelle
Rendre visite à madmoiZelle
Le médiateur du forum
Soutiens madmoiZelle financièrement
Topic dédié à la pub sur mad
Si vous aimez madmoiZelle, désactivez AdBlock !
Les immanquables
Les topics de blabla
En ce moment... !
Mode - Beauté - Ciné - Musique - Séries - Littérature - Jeux Vidéo - Etudes - Ecriture - Cuisine - People - Télévision
Envie de rencontrer des MadZ ?
Viens trouver le forum de ta ville !
Mode
Le pire de la mode
Ces vêtements qui te font envie
Ta tenue du jour
La tenue qui plaît
Tes derniers achats de fringues
Beauté
Astuces,bons plans économies & dupes
Le topic des vernis
Questions beauté en tout genre
Culture
Le meilleur des images du net
L'aide aux devoirs
Tu écoutes quoi ?
Quelle est ta série du moment ?
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Le dernier film que vous avez vu à la maison
Le topic philosophique
Société
Topic des gens qui cherchent du travail
Voyager seule : conseils et témoignages
Trucs nuls de la vie d'adulte : CAF, Banque, Mutuelle, Logement etc...
Les topics universels
Je ne supporte pas
Je ne comprends pas
Ca me perturbe
Je me demande
J'adore...
Je m'en veux de penser ça mais...
Cupidon
Le topic des amoureuses
Le topic des polyamoureuses
Les Célibattantes