Pour répondre franchement : oui, je me suis posé la question de savoir comment je réagirai le jour où on me donnera l’ordre d’ouvrir le feu. Même s’il est peu probable que ce jour arrive. A mon sens, tout représentant des forces de l’ordre devrait se poser la question, et y apporter une réponse personnelle. On a des cours là-dessus qui sont inclus dans les formations militaires, mais ce ne sont que des débuts de pistes de réflexions.
Dans mon cas, je me dois de pousser le raisonnement un cran plus loin, car je peux être confrontée à une situation où ce serait à moi de donner un ordre d’ouverture du feu.
Ce qui a beaucoup compté pour moi, dans ma réflexion personnelle, c’est le cadre juridique dans lequel évolue l’armée française d’aujourd’hui.
L’action des forces armées en opération extérieure se fait dans un cadre juridique très précis : c’est le droit des conflits armés, aussi appelé droit humanitaire international.
En droit des conflits armés, on raisonne en combattant / non-combattant (et non pas en coupable / innocent). Les combattants constituent des objectifs militaires acceptables (façon polie de dire qu’ils peuvent être tués), les non-combattants, non. Ça, c’était le raisonnement historique, du temps où la guerre opposait des armées aux équipements comparables et aux uniformes distinctifs.
Dans les conflits actuels, la distinction combattant / non-combattant est beaucoup plus difficile à faire. Les groupes armés organisés qui forment l’essentiel de nos ennemis sur le terrain ne portent pas d’uniforme particulier, se cachent dans des hôpitaux, des écoles, des monuments historiques (autant de bâtiments qui sont protégés par le droit international).
Le droit des conflits armés s’est développé en conséquence, et définit aujourd’hui de façon très précise les contours de l’action militaire. C’est extrêmement contraignant pour les forces françaises (dans l’absolu, on a les moyens de tout ratiboiser), mais c’est tout à l’honneur de la France, je trouve, de s’astreindre à un cadre juridique utilisé contre nous par nos ennemis (dont le mode d’action principal reste l’attentat sur des civils, et la pose d’engins explosifs improvisés, rappelons-le).
Un de mes métiers, pour lequel je suis encore en formation, c’est d’être conseiller juridique en opération extérieure. C’est-à-dire être capable de conseiller les chefs militaires au regard du droit international humanitaire. Ce sera à moi de m’assurer (ou, au moins, de faire pencher la balance à la mesure de mes moyens) que l’usage qui est fait de la force est le strict minimum nécessaire à l’accomplissement de la mission.
Par exemple, dans le cas où un groupe ennemi de combattants identifiés se cache dans un hôpital pour nous tirer dessus, et où mon unité reçoit l’ordre de les neutraliser : tout sera mis en œuvre pour évacuer l’hôpital, et c’est un petit groupe de soldats qui sera envoyé au corps à corps, appuyé par des tireurs d’élite (c’est ce qui se fait de mieux en termes de précision du tir) et non pas un obus lancé sur l’hôpital. Voire même, si on estime que l’opération fait prendre un risque démesuré aux non-combattants qui sont dans l’hôpital, la mission serait abandonnée. (Ceci est un exemple purement fictif étudié en cours, pas un fait réel)
Chacun des militaires de l’armée française est un professionnel formé à respecter le droit des conflits armés, c’est-à-dire à utiliser le niveau de violence minimal nécessaire à l’accomplissement de la mission. Cette formation fera partie à terme de mes attributions. J’ai la satisfaction morale de contribuer à tirer vers le bas le niveau de violence engagée, à ma petite échelle, à mon petit niveau, et je trouve que c’est faire le meilleur usage possible de mon petit bout de monopole de la violence légitime (pour reprendre l’expression de Max Weber, dans sa réflexion sur l’Etat).
Finalement, ça rejoint un peu mon combat quotidien féministe en milieu hostile : c’est en étant au cœur du système qu’on a le plus de leviers pour faire changer les choses.
J’en oublie presque de répondre sur un autre point déjà abordé : pour porter l’uniforme, il faut aussi accepter de mettre sa vie en péril dans le cadre de la mission.
Finalement, c’est le point avec lequel il est le plus facile de faire la paix, je trouve : moi j’accepte ce risque parce qu’il arrive en contrepartie de tout ce que m’apporte la vie militaire (cf mon premier post). Je l’accepte comme on accepte le risque de mourir quand on monte dans une voiture, quand on saute en parachute, quand on prend l’avion, quand on fait de la plongée sous-marine, de l’escalade : parce que j’estime que le jeu en vaut la chandelle. Je ne tiendrai peut-être plus ce raisonnement (ou en tout cas moins facilement) quand j’aurai des enfants, si j’en ai un jour, mais pour l’instant il me convient.
Bref, j’ai fait la paix avec l’idée d’avoir un métier qui implique d’être prêt à donner la mort, parce que j’ai une confiance suffisante (mais aussi relative et révocable) en la légitimité de mon action. Je garde en tête que la mort n’est jamais juste, et que jamais je ne la donnerai avec plaisir ou par esprit de vengeance ; et j’ai conscience que porter une arme confiée par l’Etat est une responsabilité immense, que j’essaie d’assumer avec le plus de discernement possible.
Et je maintiens qu’il faut être au cœur des pires systèmes pour avoir une chance de les changer pour le mieux.
Dans mon cas, je me dois de pousser le raisonnement un cran plus loin, car je peux être confrontée à une situation où ce serait à moi de donner un ordre d’ouverture du feu.
Ce qui a beaucoup compté pour moi, dans ma réflexion personnelle, c’est le cadre juridique dans lequel évolue l’armée française d’aujourd’hui.
L’action des forces armées en opération extérieure se fait dans un cadre juridique très précis : c’est le droit des conflits armés, aussi appelé droit humanitaire international.
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
En droit des conflits armés, on raisonne en combattant / non-combattant (et non pas en coupable / innocent). Les combattants constituent des objectifs militaires acceptables (façon polie de dire qu’ils peuvent être tués), les non-combattants, non. Ça, c’était le raisonnement historique, du temps où la guerre opposait des armées aux équipements comparables et aux uniformes distinctifs.
Dans les conflits actuels, la distinction combattant / non-combattant est beaucoup plus difficile à faire. Les groupes armés organisés qui forment l’essentiel de nos ennemis sur le terrain ne portent pas d’uniforme particulier, se cachent dans des hôpitaux, des écoles, des monuments historiques (autant de bâtiments qui sont protégés par le droit international).
Le droit des conflits armés s’est développé en conséquence, et définit aujourd’hui de façon très précise les contours de l’action militaire. C’est extrêmement contraignant pour les forces françaises (dans l’absolu, on a les moyens de tout ratiboiser), mais c’est tout à l’honneur de la France, je trouve, de s’astreindre à un cadre juridique utilisé contre nous par nos ennemis (dont le mode d’action principal reste l’attentat sur des civils, et la pose d’engins explosifs improvisés, rappelons-le).
Un de mes métiers, pour lequel je suis encore en formation, c’est d’être conseiller juridique en opération extérieure. C’est-à-dire être capable de conseiller les chefs militaires au regard du droit international humanitaire. Ce sera à moi de m’assurer (ou, au moins, de faire pencher la balance à la mesure de mes moyens) que l’usage qui est fait de la force est le strict minimum nécessaire à l’accomplissement de la mission.
Par exemple, dans le cas où un groupe ennemi de combattants identifiés se cache dans un hôpital pour nous tirer dessus, et où mon unité reçoit l’ordre de les neutraliser : tout sera mis en œuvre pour évacuer l’hôpital, et c’est un petit groupe de soldats qui sera envoyé au corps à corps, appuyé par des tireurs d’élite (c’est ce qui se fait de mieux en termes de précision du tir) et non pas un obus lancé sur l’hôpital. Voire même, si on estime que l’opération fait prendre un risque démesuré aux non-combattants qui sont dans l’hôpital, la mission serait abandonnée. (Ceci est un exemple purement fictif étudié en cours, pas un fait réel)
Chacun des militaires de l’armée française est un professionnel formé à respecter le droit des conflits armés, c’est-à-dire à utiliser le niveau de violence minimal nécessaire à l’accomplissement de la mission. Cette formation fera partie à terme de mes attributions. J’ai la satisfaction morale de contribuer à tirer vers le bas le niveau de violence engagée, à ma petite échelle, à mon petit niveau, et je trouve que c’est faire le meilleur usage possible de mon petit bout de monopole de la violence légitime (pour reprendre l’expression de Max Weber, dans sa réflexion sur l’Etat).
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
Finalement, ça rejoint un peu mon combat quotidien féministe en milieu hostile : c’est en étant au cœur du système qu’on a le plus de leviers pour faire changer les choses.
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
J’en oublie presque de répondre sur un autre point déjà abordé : pour porter l’uniforme, il faut aussi accepter de mettre sa vie en péril dans le cadre de la mission.
Finalement, c’est le point avec lequel il est le plus facile de faire la paix, je trouve : moi j’accepte ce risque parce qu’il arrive en contrepartie de tout ce que m’apporte la vie militaire (cf mon premier post). Je l’accepte comme on accepte le risque de mourir quand on monte dans une voiture, quand on saute en parachute, quand on prend l’avion, quand on fait de la plongée sous-marine, de l’escalade : parce que j’estime que le jeu en vaut la chandelle. Je ne tiendrai peut-être plus ce raisonnement (ou en tout cas moins facilement) quand j’aurai des enfants, si j’en ai un jour, mais pour l’instant il me convient.
Bref, j’ai fait la paix avec l’idée d’avoir un métier qui implique d’être prêt à donner la mort, parce que j’ai une confiance suffisante (mais aussi relative et révocable) en la légitimité de mon action. Je garde en tête que la mort n’est jamais juste, et que jamais je ne la donnerai avec plaisir ou par esprit de vengeance ; et j’ai conscience que porter une arme confiée par l’Etat est une responsabilité immense, que j’essaie d’assumer avec le plus de discernement possible.
Et je maintiens qu’il faut être au cœur des pires systèmes pour avoir une chance de les changer pour le mieux.
Dernière édition :
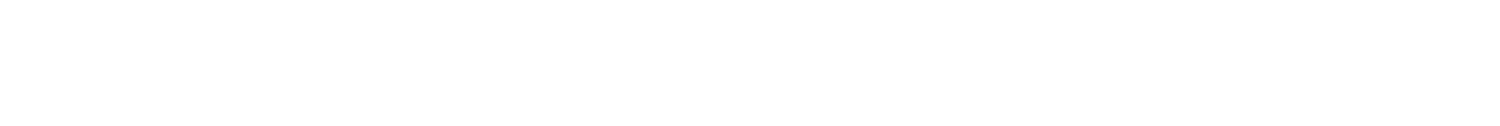

 . Ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que certains considèrent que toute personne engagée, politisée et avec une morale doit renoncer à travailler dans l'armée, voire dans la Police... ok, mais du coup ça veut dire que seuls les gens scrupules peuvent y travailler? Donc on accepte que ces corps de métiers seront toujours gangrénés de personnes sans idéaux politiques, qui cherchent la violence et les inégalités? Parce que ça me parait un peu risqué de tout faire pour décourager les gens qui ont des valeurs humanistes fortes de rentrer dans l'armée tout en reconnaissant que c'est une institution nécessaire, ça impliquerait de laisser un organe qui détient un certain monopole de la force, de la guerre et de la violence à des gens qui n'ont aucune empathie et seulement des engagements d'extrême-droite ou conservateur... perso ça me parait pire que dangereux, et ça explique probablement une partie des dérives qu'on voit actuellement, parce que beaucoup de gens qui pensent avoir des valeurs évitent l'armée de peur de se trahir.
. Ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que certains considèrent que toute personne engagée, politisée et avec une morale doit renoncer à travailler dans l'armée, voire dans la Police... ok, mais du coup ça veut dire que seuls les gens scrupules peuvent y travailler? Donc on accepte que ces corps de métiers seront toujours gangrénés de personnes sans idéaux politiques, qui cherchent la violence et les inégalités? Parce que ça me parait un peu risqué de tout faire pour décourager les gens qui ont des valeurs humanistes fortes de rentrer dans l'armée tout en reconnaissant que c'est une institution nécessaire, ça impliquerait de laisser un organe qui détient un certain monopole de la force, de la guerre et de la violence à des gens qui n'ont aucune empathie et seulement des engagements d'extrême-droite ou conservateur... perso ça me parait pire que dangereux, et ça explique probablement une partie des dérives qu'on voit actuellement, parce que beaucoup de gens qui pensent avoir des valeurs évitent l'armée de peur de se trahir.