Jusqu'ici, notre étude sur le bonheur ne nous a guère appris que ce que tout le monde savait déjà. Si nous voulons la compléter en recherchant maintenant pourquoi il est si difficile aux hommes de devenir heureux, notre chance de découvrir du nouveau ne semble pas beaucoup plus grande. Car nous avons déjà donné la réponse en signalant les trois sources d'où découle la souffrance humaine : la puissance écrasante de la nature, la caducité de notre propre corps, et l'insuffisance des mesures destinées à régler les rapports des hommes entre eux, que ce soit au sein de la famille, de l'État ou de la société. En ce qui concerne les deux premières sources, nous ne saurions hésiter longtemps, notre jugement nous contraint à en reconnaître la réalité, comme à nous soumettre à l'inévitable. Jamais nous ne nous rendrons entièrement maîtres de la nature ; notre organisme, qui en est lui-même un élément, sera toujours périssable et limité dans son pouvoir d'adaptation, de même que dans l'amplitude de ses fonctions. Mais cette constatation ne doit en rien nous paralyser ; bien au contraire, elle indique à notre activité la direction à suivre. Si nous ne pouvons abolir toutes les souffrances, du moins sommes-nous capables d'en supprimer plus d'une, d'en apaiser d'autres : une expérience plusieurs fois millénaire nous en a convaincus. Nous observons toutefois une attitude différente envers la troisième source de souffrance, la souffrance d'origine sociale. Nous nous refusons obstinément à l'admettre, nous ne pouvons saisir pourquoi les institutions dont nous sommes nous-mêmes les auteurs ne nous dispenseraient pas à tous protection et bienfaits. De toute façon, si nous réfléchissons au déplorable échec, dans ce domaine précisément, de nos mesures de préservation contre la souffrance, nous nous prenons à soupçonner qu'ici encore se dissimule quelque loi de la nature invincible, et qu'il s'agit cette fois-ci de notre propre constitution psychique.
En abordant l'examen d'une telle éventualité, nous nous heurtons à une assertion maintes fois entendue, mais si surprenante qu'il y a lieu de nous y arrêter. D'après elle, c'est ce que nous appelons notre civilisation qu'il convient de rendre responsable en grande partie de notre misère ; et de l'abandonner pour revenir à l'état primitif nous assurerait une somme bien plus grande de bonheur. Je déclare cette assertion surprenante parce qu'il est malgré tout certain - quelle que soit la définition donnée au concept de civilisation - que tout ce que nous tentons de mettre en œuvre pour nous protéger contre les menaces de souffrance émanant de l'une ou l'autre des sources déjà citées relève précisément de cette même civilisation.


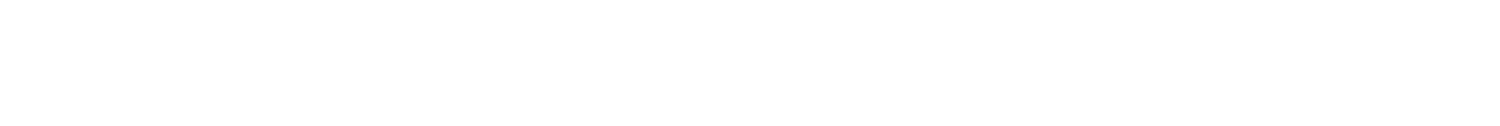


 Pour nombre de philosophes, un état pré-social est un état de guerre, parce que notre propre conservation légitime tous nos comportements, jusqu'au meurtre. L'état social puis civil c'est quand même ce qui permet de réguler les rapports entre les Hommes, ça sert à éviter le plus possible la souffrance et ce de manière égale, donc oui ça vise un certain bien-être collectif. Du coup je me demande vraiment quelles sont, pour les partisans du FN ou globalement toutes les personnes perpétuant injustices, intolérances et discriminations, les raisons d'être de la civilisation, de la politique... (Personne pour faire un sondage ?
Pour nombre de philosophes, un état pré-social est un état de guerre, parce que notre propre conservation légitime tous nos comportements, jusqu'au meurtre. L'état social puis civil c'est quand même ce qui permet de réguler les rapports entre les Hommes, ça sert à éviter le plus possible la souffrance et ce de manière égale, donc oui ça vise un certain bien-être collectif. Du coup je me demande vraiment quelles sont, pour les partisans du FN ou globalement toutes les personnes perpétuant injustices, intolérances et discriminations, les raisons d'être de la civilisation, de la politique... (Personne pour faire un sondage ?  )
)