Bref, @Charlotte Arce et toute l'équipe, c'est franchement moyen de publier ce genre de témoignage sans recherche derrière.
Commentaires sur « Mon fils de 4 ans a vu sa sœur naître » : Anaïs nous raconte son accouchement à la maison sans assistance
- Initiateur de la discussion Charlotte Arce
- Date de début
Vous utilisez un navigateur obsolète. Il se peut que ce site ou d'autres sites Web ne s'affichent pas correctement.
Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
@kandinskette
@Mary-Sue
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
@Mary-Sue
Je viens de lire le fameux article qui dit "Il est prouvé que les l’hypermédicalisation augmente le risque de complications." (je cite le témoignage et la transcription de @Charlotte Arce .
@Charlotte Arce et toute l'équipe, je ne connais pas votre métier, mais c'est franchement dangereux de citer des articles sous ce genre de titre. Et de les vulgariser avec ce genre de propos :
Rien que le titre : "La médicalisation de l’accouchement : impacts possibles sur la santé mentale et physique des familles".
On parle d'impacts possible, mais ça se transforme en "il est prouvé".
"Ce type d’accouchement est défini ici comme le fait d’être suivie par une sage-femme pendant la grossesse et de ne pas avoir recours à des méthodes liées au milieu hospitalier : épidurale, monitoring fœtal, déclenchement du travail, césarienne, etc. L’accouchement peut se dérouler à l’hôpital, en maison de naissance ou à domicile." = donc pas un accouchement sans professionnel. Grossesse suivi, accouchement également.
Sérieusement, il y a des journalistes à Madmoizelle ?
Bref, je ne vais pas continuer, rien que les premières phrases disent que cet article scientifique n'a rien à faire dans ce témoignage @Charlotte Arce . De plus, il s'agit de chiffre du Québec, Canada, pays où la plupart d'entre nous n'habitons pas et ne sommes pas concernées par les mesures hospitalières.
Je viens de lire le fameux article qui dit "Il est prouvé que les l’hypermédicalisation augmente le risque de complications." (je cite le témoignage et la transcription de @Charlotte Arce .
@Charlotte Arce et toute l'équipe, je ne connais pas votre métier, mais c'est franchement dangereux de citer des articles sous ce genre de titre. Et de les vulgariser avec ce genre de propos :
Rien que le titre : "La médicalisation de l’accouchement : impacts possibles sur la santé mentale et physique des familles".
On parle d'impacts possible, mais ça se transforme en "il est prouvé".
"Ce type d’accouchement est défini ici comme le fait d’être suivie par une sage-femme pendant la grossesse et de ne pas avoir recours à des méthodes liées au milieu hospitalier : épidurale, monitoring fœtal, déclenchement du travail, césarienne, etc. L’accouchement peut se dérouler à l’hôpital, en maison de naissance ou à domicile." = donc pas un accouchement sans professionnel. Grossesse suivi, accouchement également.
Sérieusement, il y a des journalistes à Madmoizelle ?
Bref, je ne vais pas continuer, rien que les premières phrases disent que cet article scientifique n'a rien à faire dans ce témoignage @Charlotte Arce . De plus, il s'agit de chiffre du Québec, Canada, pays où la plupart d'entre nous n'habitons pas et ne sommes pas concernées par les mesures hospitalières.
Dernière édition :
Ah oui, effectivement, que ma mère ait pu bénéficier d'une césarienne en urgence qui m'a sauvé la vie à la naissance, ça a eu un lourd impact...(pardon, j'en deviens cynique, mais le discours de Quantik Mama me dépasse.)
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
@kandinskette
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
@kandinskette
Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici.
@A Kane
Personne n'a dit que c'était un miracle et encore une fois, le débat pour moi porte plus sur le discours anti-médecine + la présence du gamin à un accouchement sans aucune supervision que sur l'accouchement sans supervision en lui-même, puisque comme tu dis, elle fait bien ce qu'elle veut.
et encore une fois, le débat pour moi porte plus sur le discours anti-médecine + la présence du gamin à un accouchement sans aucune supervision que sur l'accouchement sans supervision en lui-même, puisque comme tu dis, elle fait bien ce qu'elle veut.
Cela dit, je reviens quand même sur la fin du témoignage, où la Madz dit que pour une prochaine grossesse, elle "allégera le suivi de grossesse" : donc potentiellement peu de suivi de grossesse + un nouvel accouchement à domicile sans supervision, puisque le premier s'est bien passé. Et là c'est quand même plus dangereux.
Ma conclusion reste toujours la même : le discours qu'elle tient peut vite amener à une pente glissante, et il faut le dire.
Personne n'a dit que c'était un miracle
 et encore une fois, le débat pour moi porte plus sur le discours anti-médecine + la présence du gamin à un accouchement sans aucune supervision que sur l'accouchement sans supervision en lui-même, puisque comme tu dis, elle fait bien ce qu'elle veut.
et encore une fois, le débat pour moi porte plus sur le discours anti-médecine + la présence du gamin à un accouchement sans aucune supervision que sur l'accouchement sans supervision en lui-même, puisque comme tu dis, elle fait bien ce qu'elle veut.Cela dit, je reviens quand même sur la fin du témoignage, où la Madz dit que pour une prochaine grossesse, elle "allégera le suivi de grossesse" : donc potentiellement peu de suivi de grossesse + un nouvel accouchement à domicile sans supervision, puisque le premier s'est bien passé. Et là c'est quand même plus dangereux.
Ma conclusion reste toujours la même : le discours qu'elle tient peut vite amener à une pente glissante, et il faut le dire.
J’ai publié l’étude anglaise parue dans The lancet aussi il y a quelques jours. C’est prouvé que dans certains cas l’hôpital comporte plus de risques.
Mais ces risques sont moins importants que ceux qu’on court toute seule. Enfin ça ne veut pas dire qu’il faut se passer de docteur ou de SF juste que l’hôpital c’est pas toujours la panacée.
Mais ces risques sont moins importants que ceux qu’on court toute seule. Enfin ça ne veut pas dire qu’il faut se passer de docteur ou de SF juste que l’hôpital c’est pas toujours la panacée.
@Pipistrelle. : ce message étayé = 
 (merci).
(merci).
Je t’ai lue attentivement, et sauf erreur de ma part, ton approche relève du constructivisme social. Courant de la sociologie que j’affectionne particulièrement.
1. Les naissances à domicile jusqu’au début du XXe siècle
Je te renvoie à une distinction que j’ai faite, ici.
En effet, dans l’exemple que tu donnes, il y a des éléments de l’accouchement qui peuvent être vus et/ou entendus, mais les enfants ne sont pas conviés, on ne leur propose pas d’être spectateurs et/ou de participer à la parturition. À partir de là, la notion de consentement ou d’absence de consentement n’intervient pas. (La définition du consentement selon Le Robert : « Acquiescement donné à un projet ; décision de ne pas s'y opposer ».)
2. « […] la capacité à assister à certaines scènes ou à participer à certains événements dépend beaucoup du contexte et du système de représentations qu'il y a autour. »
Oui, mais pas seulement. Il existe une discipline qui s’appelle la psychologie de l’enfant, qui m’intéresse dans le cadre de ce débat. La question numéro 1, c’est de savoir si une limite (socio-culturelle, mais peut-être là pour de bonnes raisons) a été dépassée. Pas ailleurs ni avant, mais ici et maintenant (en France, en 2023). Et quelles en sont les conséquences (positives, négatives, nulles) sur la vie psychique des uns et des autres, le fonctionnement familial, etc.
Il existe une discipline qui s’appelle la psychologie de l’enfant, qui m’intéresse dans le cadre de ce débat. La question numéro 1, c’est de savoir si une limite (socio-culturelle, mais peut-être là pour de bonnes raisons) a été dépassée. Pas ailleurs ni avant, mais ici et maintenant (en France, en 2023). Et quelles en sont les conséquences (positives, négatives, nulles) sur la vie psychique des uns et des autres, le fonctionnement familial, etc.
Ceci étant dit, je tiens à te remercier d’avoir apporté ta pierre à l’édifice avec une analyse sociologique qui manquait cruellement à nos échanges.

 (merci).
(merci).Je t’ai lue attentivement, et sauf erreur de ma part, ton approche relève du constructivisme social. Courant de la sociologie que j’affectionne particulièrement.
1. Les naissances à domicile jusqu’au début du XXe siècle
Je te renvoie à une distinction que j’ai faite, ici.
En effet, dans l’exemple que tu donnes, il y a des éléments de l’accouchement qui peuvent être vus et/ou entendus, mais les enfants ne sont pas conviés, on ne leur propose pas d’être spectateurs et/ou de participer à la parturition. À partir de là, la notion de consentement ou d’absence de consentement n’intervient pas. (La définition du consentement selon Le Robert : « Acquiescement donné à un projet ; décision de ne pas s'y opposer ».)
2. « […] la capacité à assister à certaines scènes ou à participer à certains événements dépend beaucoup du contexte et du système de représentations qu'il y a autour. »
Oui, mais pas seulement.
 Il existe une discipline qui s’appelle la psychologie de l’enfant, qui m’intéresse dans le cadre de ce débat. La question numéro 1, c’est de savoir si une limite (socio-culturelle, mais peut-être là pour de bonnes raisons) a été dépassée. Pas ailleurs ni avant, mais ici et maintenant (en France, en 2023). Et quelles en sont les conséquences (positives, négatives, nulles) sur la vie psychique des uns et des autres, le fonctionnement familial, etc.
Il existe une discipline qui s’appelle la psychologie de l’enfant, qui m’intéresse dans le cadre de ce débat. La question numéro 1, c’est de savoir si une limite (socio-culturelle, mais peut-être là pour de bonnes raisons) a été dépassée. Pas ailleurs ni avant, mais ici et maintenant (en France, en 2023). Et quelles en sont les conséquences (positives, négatives, nulles) sur la vie psychique des uns et des autres, le fonctionnement familial, etc.Ceci étant dit, je tiens à te remercier d’avoir apporté ta pierre à l’édifice avec une analyse sociologique qui manquait cruellement à nos échanges.

Discussions similaires
- Réponses
- 0
- Affichages
- 172
- Réponses
- 0
- Affichages
- 2 K
- Réponses
- 0
- Affichages
- 432
- Réponses
- 0
- Affichages
- 360
Les Immanquables du forum
Participe au magazine !
Une info qu'on devrait traiter sur madmoiZelle ?
Nouvelle ou perdue ?
Pas de panique, on t'aime déjà !
La charte de respect du forum
Le guide technique &
le guide culturel du forum
Viens te présenter !
Un problème technique ?
Topic d'entraide sur l'orthographe et la grammaire
La chefferie vous informe
Les annonces de l'équipe concernant le forum et madmoiZelle
Rendre visite à madmoiZelle
Le médiateur du forum
Soutiens madmoiZelle financièrement
Topic dédié à la pub sur mad
Si vous aimez madmoiZelle, désactivez AdBlock !
Les immanquables
Les topics de blabla
En ce moment... !
Mode - Beauté - Ciné - Musique - Séries - Littérature - Jeux Vidéo - Etudes - Ecriture - Cuisine - People - Télévision
Envie de rencontrer des MadZ ?
Viens trouver le forum de ta ville !
Mode
Le pire de la mode
Ces vêtements qui te font envie
Ta tenue du jour
La tenue qui plaît
Tes derniers achats de fringues
Beauté
Astuces,bons plans économies & dupes
Le topic des vernis
Questions beauté en tout genre
Culture
Le meilleur des images du net
L'aide aux devoirs
Tu écoutes quoi ?
Quelle est ta série du moment ?
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Le dernier film que vous avez vu à la maison
Le topic philosophique
Société
Topic des gens qui cherchent du travail
Voyager seule : conseils et témoignages
Trucs nuls de la vie d'adulte : CAF, Banque, Mutuelle, Logement etc...
Les topics universels
Je ne supporte pas
Je ne comprends pas
Ca me perturbe
Je me demande
J'adore...
Je m'en veux de penser ça mais...
Cupidon
Le topic des amoureuses
Le topic des polyamoureuses
Les Célibattantes
Une info qu'on devrait traiter sur madmoiZelle ?
Nouvelle ou perdue ?
Pas de panique, on t'aime déjà !
La charte de respect du forum
Le guide technique &
le guide culturel du forum
Viens te présenter !
Un problème technique ?
Topic d'entraide sur l'orthographe et la grammaire
La chefferie vous informe
Les annonces de l'équipe concernant le forum et madmoiZelle
Rendre visite à madmoiZelle
Le médiateur du forum
Soutiens madmoiZelle financièrement
Topic dédié à la pub sur mad
Si vous aimez madmoiZelle, désactivez AdBlock !
Les immanquables
Les topics de blabla
En ce moment... !
Mode - Beauté - Ciné - Musique - Séries - Littérature - Jeux Vidéo - Etudes - Ecriture - Cuisine - People - Télévision
Envie de rencontrer des MadZ ?
Viens trouver le forum de ta ville !
Mode
Le pire de la mode
Ces vêtements qui te font envie
Ta tenue du jour
La tenue qui plaît
Tes derniers achats de fringues
Beauté
Astuces,bons plans économies & dupes
Le topic des vernis
Questions beauté en tout genre
Culture
Le meilleur des images du net
L'aide aux devoirs
Tu écoutes quoi ?
Quelle est ta série du moment ?
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Le dernier film que vous avez vu à la maison
Le topic philosophique
Société
Topic des gens qui cherchent du travail
Voyager seule : conseils et témoignages
Trucs nuls de la vie d'adulte : CAF, Banque, Mutuelle, Logement etc...
Les topics universels
Je ne supporte pas
Je ne comprends pas
Ca me perturbe
Je me demande
J'adore...
Je m'en veux de penser ça mais...
Cupidon
Le topic des amoureuses
Le topic des polyamoureuses
Les Célibattantes
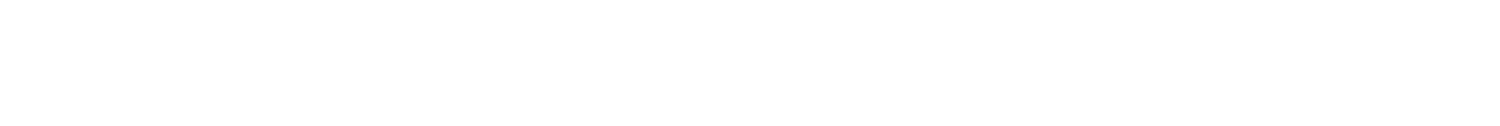

 Mais c'est prouvé, t'inquiète
Mais c'est prouvé, t'inquiète 