Oui je comprends ce que vous dites. Tout a déjà été dit, tout a déjà été compris et longuement étudié. Votre réaction me permet de me rendre compte de quelque chose.
Ce que j'essayais de faire dans ce topic "philo", c'était de proposer de
penser par soi-même, pour répondre à des questions plus ou moins existentielles. Par soi-même, et non pas à travers un regard extérieur,
quel qu'il soit.
Les scientifiques et philosophes, c'est à la fois "un bloc" de connaissances, et à la fois "le point de vue et raisonnement" de chacun de ces scientifiques et philosophes. Evidemment, ça compte ! Les nombreux désaccords et la connaissance qui continue d'augmenter démontrent que les questions sont toujours là, et que les réponses s'affinent et s'étoffent avec le temps.
Mon kif, c'est de réfléchir
par moi-même à un sujet, et autant côté scientifique j'ai compris (à travers nos échanges) que c'était un terrain extrêmement glissant, autant je pensais qu'en réorientant sur quelque chose de plus philosophique, cela pourrait mener à des échanges intéressants.
Je pensais aussi sur ce forum pouvoir discuter avec des personnes "comme moi" qui aiment bien réfléchir, développer des raisonnements, sans pour autant avoir une culture et un bagage scientifique "fourni".
J'admets mes nombreuses maladresses, la lourdeur de mes pavés, que j'ai pu être blessante, j'en suis (encore une fois) désolée, je tiens compte de vos remarques (enfin, de celles qui m'intéressent, c'est vrai... je me laisse cette liberté

). Je comprends aussi que je vous soûle

Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir ce qui fait consensus sur l'origine du patriarcat dans l'humanité grâce à tous les spécialistes qui ont fait une thèse sur le sujet (par exemple), mais sur l'image que
vous pourriez vous en faire, si vous laissiez votre pensée imaginer librement ce qui a bien pu se passer... Moi c'est ce que je fais : je me pose une question, et ensuite je déroule le fil de ma pensée (avec toutes les digressions que cela impose)
pour voir comment mon imagination peut trouver de la logique à... "l'ensemble de ce qui existe", puisque dès qu'on commence, ça ne s'arrête plus.

Et ce qui est absolument formidable, c'est qu'en déroulant mon fil de pensée
sans m'être documentée auparavant, je retombe
après sur des théories/écrits/preuves qui viennent (relativement) soutenir le fil de ce que mon imagination a inventé.
Relativement j'ai dit !

Et bref, voilà.

Du coup s'il y en a qui sont motivé.es on peut essayer de répondre à cette question ?

la meuf qui se décourage pas  "Peut-on penser par soi-même le monde lorsqu'on se contraint à passer d'abord par tous les filtres de la connaissance déjà établie ?"
"Peut-on penser par soi-même le monde lorsqu'on se contraint à passer d'abord par tous les filtres de la connaissance déjà établie ?"
(et peut-on répondre à cette question par nous-mêmes ? sans aller chercher une source pour fabriquer un raisonnement et une conclusion à notre place ?...

)
(oui j'ose)
 ) les gens en général agissent d'une façon qui suit leur intuition, et d'une façon contre-intuitive (que j'interprète par "faire quelque chose alors qu'au fond de soi on n'est pas vraiment d'accord").
) les gens en général agissent d'une façon qui suit leur intuition, et d'une façon contre-intuitive (que j'interprète par "faire quelque chose alors qu'au fond de soi on n'est pas vraiment d'accord").
 ) les gens en général agissent d'une façon qui suit leur intuition, et d'une façon contre-intuitive (que j'interprète par "faire quelque chose alors qu'au fond de soi on n'est pas vraiment d'accord").
) les gens en général agissent d'une façon qui suit leur intuition, et d'une façon contre-intuitive (que j'interprète par "faire quelque chose alors qu'au fond de soi on n'est pas vraiment d'accord").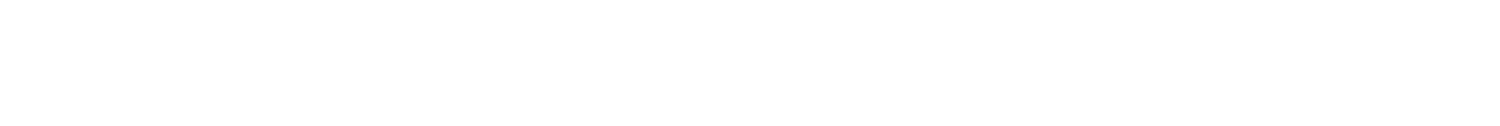

 si on observe l'impact global d'un mode de vie et de l'autre, ma constatation c'est que les tribus primitives ET notre environnement à tous (le leur ET le nôtre) se font décimer par le monde "développé", alors que l'inverse n est pas vrai : non seulement elles ont un impact quasi nul sur l'environnement (le leur ET donc celui de la planète), mais en + leur mode de vie n est pas prédateur sur le nôtre : ils ne nous font pas de mal et manifestement ne cherchent pas à le faire (évidemment s'ils voulaient ils seraient bien trop peu armés face à nous, mais ça n'est pas vraiment la question
si on observe l'impact global d'un mode de vie et de l'autre, ma constatation c'est que les tribus primitives ET notre environnement à tous (le leur ET le nôtre) se font décimer par le monde "développé", alors que l'inverse n est pas vrai : non seulement elles ont un impact quasi nul sur l'environnement (le leur ET donc celui de la planète), mais en + leur mode de vie n est pas prédateur sur le nôtre : ils ne nous font pas de mal et manifestement ne cherchent pas à le faire (évidemment s'ils voulaient ils seraient bien trop peu armés face à nous, mais ça n'est pas vraiment la question  )
)
 C'est tellement condescendant ! Tu ne t'en rends sans doute pas compte mais c'est vraiment une vision très très archaïque des sociétés différentes de la notre.
C'est tellement condescendant ! Tu ne t'en rends sans doute pas compte mais c'est vraiment une vision très très archaïque des sociétés différentes de la notre.





 ).
).