Elle est intéressante, l'étude.
La méthodologie est délivrée au début : pour résumer, ils ont donné un carnet aux personnes interrogées, qui devaient noter par tranche de dix minutes les deux activités principales pratiquées (selon une liste donnée plutôt complète), en indiquant le début et la fin de cette journée.
Pour ce qui est du travail, on obtient donc pour les femmes en emploi (ce qui n'inclue pas les chômeurs, les retraités ou les étudiants, qui ont leurs chiffres à eux) 4h49, contre 6h05 pour les hommes en emploi. Pour les activités ménagères des mêmes groupes, on a 3h43 pour les femmes et 2h12 pour les hommes. Pour les activités personnelles de récupération, c'est kif kif, juste les femmes en emploi qui dorment une demi-heure de plus, demi-heure rattrapée sur le temps libre par les hommes.
Du coup, la comparaison ne se fait pas à journée de travail égale, donc ça ne dit pas que les femmes passent plus de temps à socialiser/glander au boulot, juste qu'elles occupent une moins grande part de leur journée à travailler. Ce qui peut très bien se comprendre si les femmes ont globalement des emplois avec des journées de travail plus courtes, ou avec moins de jours dans la semaine.
Cela dit, la première interprétation que vous avez faite, aurait de quoi être remarquable si elle existait sous forme d'étude. Cependant, je pense que c'est plus difficile d'avouer qu'on glande pendant ses heures de boulot, donc peut-être que les chiffres seraient plus délicats à recueillir.

Pour le disclamer au début, je pense qu'il est là plus pour justifier des réflexions de ce type :
Enfin, l’observation des carnets « Stiglitz » donne quelques pistes de réflexion sur les rapports entre le travail et le jeu dans les représentations. Il semblerait que les parents des classes populaires n’aiment pas beaucoup surveiller les devoirs de leurs enfants quand les cadres au contraire en retirent beaucoup de satisfactions. Il est probable que les ouvriers et les employés ne se sentent pas assez compétents pour ce travail d’éducation. Par contre, ils apprécient plus que les cadres les moments passés à jouer avec leurs enfants. Ce résultat qui demanderait toutefois à être confirmé à l’aide d’un échantillon de plus grande taille, rappelle la thèse de Chamboredon selon laquelle la forte opposition entre le travail et le jeu dans les classes populaires tandis que dans les classes cultivées, « on peut et on sait travailler tout en jouant et inversement, traiter un travail comme un jeu » (1973 ; réed. 2015).
Puisqu'on avance des hypothèses pour expliquer certains phénomènes. Je ne crois pas que cela vienne remettre en doute les données trouvées, mais seulement les raisons suggérées. Histoire que si un ouvrier les attaque en leur disant "Je me sens parfaitement compétent pour ce travail éducationnel, enfin !

", ils puissent sortir la carte des interprétations personnelles. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
Ensuite, j'ai extrait la partie qui nous préoccupe (il y a d'autres informations que je juge intéressantes, notamment celles sur la répartition des tâches ménagères et le temps qui leur est consacrée, mais bon, on va s'en tenir à ça) :
Pour les femmes, l’activité professionnelle est subordonnée aux contraintes familiales
L’observation des parcours des femmes sur le marché du travail montre que leur réalisation professionnelle dépend, plus que celle des hommes, des contraintes familiales. Tout d’abord, quand elles ne sont pas produites par une pénurie d’emploi, les interruptions d’activité professionnelle des femmes résultent souvent de l’élargissement de la famille. En France, plus de la moitié des mères d’enfants de huit ans ou plus s’est arrêtée de travailler après la naissance de ses enfants ou a réduit temporairement son activité rémunérée, au moins un mois au‑delà de son congé de maternité, contre 12 % des pères (Govillot, 2013).
Ensuite, chez les femmes en emploi, la durée de l’activité professionnelle dépend assez fortement de la composition de leur ménage, comme confirme la régression détaillée dans le tableau A de l’annexe. Celles qui vivent seules travaillent plus que celles qui sont en couple et qui n’ont pas d’enfant (35h50 par semaine contre 33h30).
Et les mères de famille qui occupent un emploi et ont un enfant consacrent chaque semaine 34h à leur activité professionnelle, contre seulement 26h30 si elles en ont trois ou plus. Cette moindre durée correspond en partie à des emplois à temps partiel. Ainsi, la part des mères de famille à temps partiel passe par exemple de 24 % quand elles ont un seul enfant à 42 % lorsqu’elles en ont trois ou plus. D’ailleurs, 35 % des femmes (et à peine 7 % des hommes) déclarent travailler à temps partiel pour s’occuper de leurs enfants ou de leurs parents (Ulrich et Zilberman, 2007). L’abandon du temps plein pour le temps partiel, suite à la venue d’un enfant est plus fréquent chez les femmes cadres pour qui cette forme d’horaire est plus souvent choisie que subie, contrairement aux ouvrières et aux employées (Govillot, 2013). A cela s’ajoute le fait que les mères de famille ont des journées de travail d’autant plus courtes que leur charge parentale est lourde, et ceci qu’elles exercent à temps plein ou à temps partiel. La modulation de la durée du travail selon le nombre d’enfants est beaucoup moins courante chez les hommes. Tout au plus, observe‑t‑on, « toutes choses égales par ailleurs », une durée des journées de travail plus basse d’une trentaine de minutes pour les hommes ayant deux enfants, dont au moins un de moins de trois ans (cf. annexe, tableau B). En définitive, à mesure que la fonction parentale prend de l’importance, les rôles masculins et féminins se différencient.
Du coup, ça ne me semble pas incohérent. Les femmes sont plus souvent à temps partiel, ont des journées de travail plus courtes en temps partiels ou en temps pleins, notamment quand elles ont une charge parentale importante. Et ceci touche vraisemblablement moins les hommes : "La modulation de la durée du travail selon le nombre d’enfants est beaucoup moins courante chez les hommes." Je ne sais pas s'il faut forcément y voir une tare, c'est juste qu'on a encore un plus grand nombre de femmes qui privilégient leur vie de famille à leur vie professionnelle que d'hommes.

Une comparaison à poste égal serait peut-être plus déterminante, je trouve. Par exemple, est-ce que, pour deux cadres exerçant les mêmes fonctions, la femme travaille en moyenne moins que l'homme, en volume horaire ? Ça pourrait expliquer certaines différences de salaire, à ce niveau (sans toutes les justifiées, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit).

J'ai peut-être manqué la partie qui ferait pareille comparaison dans le document, la lecture des tableaux format-paysage-mais-présentés-en-portrait-ouille-mes-yeux sur ordi est assez laborieuse.









 Comment ça pourrait ne pas être biaisé? Heureusement qu'il y a ce disclaimer parce que pour le coup,c'est choquant.
Comment ça pourrait ne pas être biaisé? Heureusement qu'il y a ce disclaimer parce que pour le coup,c'est choquant.







 Comment ça pourrait ne pas être biaisé? Heureusement qu'il y a ce disclaimer parce que pour le coup,c'est choquant.
Comment ça pourrait ne pas être biaisé? Heureusement qu'il y a ce disclaimer parce que pour le coup,c'est choquant.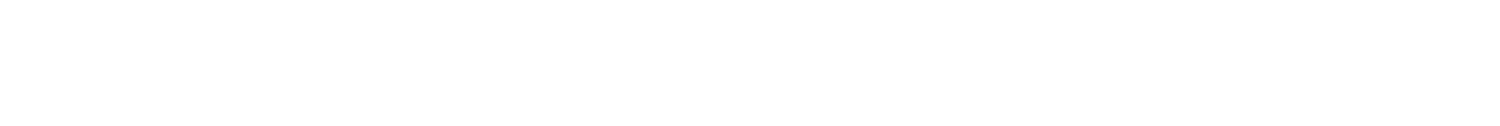



 ", ils puissent sortir la carte des interprétations personnelles. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
", ils puissent sortir la carte des interprétations personnelles. Enfin, c'est l'impression que j'ai. J'ai peut-être manqué la partie qui ferait pareille comparaison dans le document, la lecture des tableaux format-paysage-mais-présentés-en-portrait-ouille-mes-yeux sur ordi est assez laborieuse.
J'ai peut-être manqué la partie qui ferait pareille comparaison dans le document, la lecture des tableaux format-paysage-mais-présentés-en-portrait-ouille-mes-yeux sur ordi est assez laborieuse.